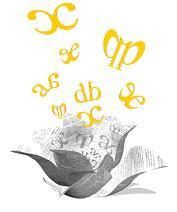Quoi de commun, me direz-vous entre l’entreprise SPIE-Batignolles (4e groupe français de construction) et l’abbaye de Royaumont, monument historique du Val d’Oise ? Et pourquoi sur ce blog ? À cette dernière question, je réponds qu’il y a longtemps que je caresse l’idée d’y faire un peu d’histoire du patrimoine industriel – c’est aussi une partie de notre patrimoine, peu souvent évoquée, ni au niveau académique, ni sur Internet.

À la première question : le point commun entre SPIE-Batignolles (ci-dessus) et Royaumont (ci-dessous), c’est la famille Goüin – et je vous invite à un parcours à travers une histoire familiale, industrielle et culturelle française.

Abbaye de Royaumont (Val d'Oise) (WikiCommons cc-by-sa GFreihalter)
(presque)Tout commence avec Ernest Goüin (1815-1885), fils de no(ta)bles tourangeaux[1]. Polytechnicien (X1834), fortement inspiré par le développement du chemin de fer en Angleterre, il fonde en 1846, avec l’appui de divers banquiers, dont le saint-simonien[2] Talabot (lui aussi polytechnicien), la première usine française de matériel ferroviaire (voitures, locomotives), dans le quartier des Batignolles le long de l’avenue de Clichy à Paris.
 Ernest Goüin (1815-1885)
Ernest Goüin (1815-1885)
L’entreprise se diversifie dans la fabrication de navires (avec un chantier naval à Nantes), de métiers à tisser, de ponts et ouvrages d’art – comme le pont ferroviaire d’Asnières (1851), premier pont français à tablier métallique, ou le pont de la rue du Rocher à Paris (1868). Rebaptisée en 1871 société de construction des Batignolles, elle fournit même les perforatrices destinées à la première tentative d’un tunnel sous la Manche, en 1885 !

Le pont de la rue du Rocher, Paris VIIIe (photo Gérard Métron, site struturae.info)
L’histoire de l’entreprise suit celle de la IIIe République, notamment celle de l’empire colonial. Après la mort d’Ernest – dont le nom est parmi les 72 savants et ingénieurs honorés par Eiffel sur sa tour –, ce sont Jules (1846-1908), son fils (centralien) puis ses petits-fils Gaston (1877-1921) (aussi centralien), Gaston, Edouard et Ernest II (1881-1967) qui mènent l’entreprise. Elle construit la ligne ferroviaire Bône-Guelma, entre Algérie et Tunisie, les chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan (1901) – avec le soutien de la Banque de l’Indochine –, le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis du Sénégal (1883).

Jules Goüin (costume civil, à g.) lors de l'inauguration du Pont Troïtsky sur la Neva par le tzar Nicolas II et la tsarine, le 19 mai 1903 (photo WikiCommons)
L’histoire des années sombres traverse aussi l’entreprise. Henry Goüin (1900-1977), fils d’Édouard, est déporté, tandis qu’Ernest II, président de l’entreprise, est arrêté à la Libération et passe 9 mois en prison. Après-guerre, elle développe du matériel pour l’industrie pétrolière et gazière (notamment en son usine de Nantes, qui sera disloquée en 1985 entre trois repreneurs, toujours actifs), construit le barrage de Donzère-Mondragon sur le Rhône (1952). La société de construction des Batignolles est rachetée par le groupe SPIE du baron Empain en 1951 – mais Henry Goüin reste à la tête de l’entreprise, jusqu’à la fusion SPIE-Batignolles en 1968.

La palais abbatial, de style palladien (WikiCommons cc-by-sa B. Poschadel)
Et Royaumont, dans tout ça ? Jules Goüin, fils d’Edouard, avait racheté en 1898 le palais abbatial (résidence de l’abbé, aujourd’hui séparée de l’abbaye, et rachetée en 1922 aux Goüin par une branche Rotschild – aujourd’hui toujours en leur possession) et en avait fait sa résidence secondaire. En 1905, lors de la loi de séparation de l’Église et de l’État, il rachète l’abbaye aux congrégations. Trente ans plus tard, son neveu Henry (1900-1977), [source abbaye Royaumont] « séduit par les initiatives du Front populaire en faveur des travailleurs, décide d’ouvrir les portes de Royaumont aux artistes et intellectuels nécessiteux […] Le 15 mai 1938, il inaugure avec son épouse, Isabel Goüin-Lang, le Foyer de Royaumont, lieu de travail et de repos pour artistes et intellectuels. Vingt-six ans plus tard, en 1964, le projet sera pérennisé sous la forme d’une Fondation Royaumont (GoüinLang) pour le progrès des Sciences de l’Homme.». Ce projet, mené avec le soutien du ministre Malraux, est à l’époque la première fondation privée culturelle en France. La mort d’Henry Goüin en 1977 ralentit le dynamisme de la Fondation, qui par la suite, avec le soutien du Conseil général du Val d’Oise, devient un lieu de concert et d’hébergement d’artistes autour de la musique vocale.

Quelques références :
- Anne Burnel, La Société de construction des Batignolles de 1914-1939 : histoire d'un déclin, Librairie Droz, 1995.
- Rang-Ri Park-Barjot, La Société de construction des Batignolles: Des origines à la Première Guerre mondiale (1846-1914), Presses Paris Sorbonne, 2005.
- Jacques-Marie Vaslin, « Ernest Goüin, le polytechnicien des Batignolles », Le Monde (économie), 22 novembre 2010.
- Henry Goüin, L’Abbaye de Royaumont, 1932 (préface d’H. Laurens, 93 p., 41 photographies N&B).
- Jean-François Belhoste, Nathalie Le Gonidec (dir.), Royaumont au XIXe siècle - Les métamorphoses d'une abbaye, Créaphis, 2008.
[1] Son grand-père Goüin-Moisant (1758-1823), détenait la banque Goüin, fondée à Tours en 1714, et fut député royaliste de 1815 à 1823. C’était une famille noble – quoique sans particule – son blason est D’azur à croix tréflée d’or.
[2] Il y a une inclination saint-simonienne aussi chez Goüin, comme chez de nombreux polytechniciens du XIXe siècle. Il affirme (cité par Le Monde, 2010), que « la puissance n'est légitime que si elle s'exerce pour le bien de tous ». Dès 1847, il met en place une société de secours mutuel qui fait office de Sécurité sociale pour les employés.
/image%2F1527442%2F20240306%2Fob_de3d75_gareorsay.jpg)
/image%2F1527442%2F20240306%2Fob_04846b_estrornans.jpg)



/image%2F1527442%2F20240207%2Fob_1473c0_image1.jpg)
/image%2F1527442%2F20240207%2Fob_2caf8d_image2.jpg)